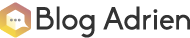Jacques Delors, président de la Commission européenne de 1985 à 1995, a profondément marqué l'histoire de l'Union européenne. Son mandat, souvent résumé par l'expression "le choix de Delors", a impulsé une intégration européenne sans précédent, façonnant l'Europe que nous connaissons aujourd'hui.
Contexte européen: années 1980 - une Europe en crise et à la croisée des chemins
Les années 1980 ont été une période de profondes mutations pour l'Europe. Une crise économique majeure a sévi, avec un taux de chômage culminant à plus de 11% dans certains pays de la Communauté européenne en 1986. Les inégalités sociales se sont creusées, alimentant un sentiment de malaise et de méfiance envers les institutions européennes. Le Système Monétaire Européen (SME), instauré en 1979, peinait à maintenir la stabilité des changes. Simultanément, un euroscepticisme croissant, nourri par les difficultés économiques et les doutes sur l'efficacité du projet européen, gagnait du terrain. Le PIB européen stagnait, contrairement à la croissance des années 1960 et 1970.
La chute du Mur de Berlin en 1989 a brutalement transformé le paysage géopolitique. La fin de la Guerre Froide a ouvert la voie à une réunification allemande, mais a également posé le défi crucial de l'intégration des pays d'Europe de l'Est dans un nouvel ordre européen. Cette perspective inédite a nécessité une révision complète de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'UE, la préparation d'un élargissement considérable et une adaptation des institutions européennes à une réalité géopolitique profondément modifiée. Le nombre d'États membres de l'UE a quasiment doublé depuis 1989.
À l'intérieur de la Communauté, des pressions internes fortes se sont manifestées. Les revendications sociales concernant l'emploi, la protection sociale et la réduction des inégalités étaient particulièrement vives. Des tensions entre États membres, souvent liées à des intérêts nationaux divergents, ont compliqué le processus d'intégration européenne. La comparaison avec les approches de Margaret Thatcher au Royaume-Uni (néolibéralisme) et d'Helmut Kohl en Allemagne (coopération européenne) met en lumière les options alternatives qui s'offraient alors aux décideurs européens. La stratégie de Delors a marqué une voie médiane, cherchant à concilier progrès économiques et cohésion sociale.
- Le chômage dans l'UE a atteint un pic de 11,1% en 1986.
- L'inflation européenne a été maîtrisée grâce aux politiques monétaires coordonnées.
- La réunification allemande en 1990 a marqué un tournant majeur pour l'Europe.
Les piliers du "choix de Delors": vers une intégration approfondie
L'acte unique européen (1986) : un cadre juridique renforcé
L'Acte Unique Européen (AUE) de 1986 a constitué une étape majeure dans le processus d'intégration. Il a élargi les compétences de la Communauté européenne au-delà du simple marché commun, ouvrant la voie à une coopération renforcée dans des domaines jusque-là laissés aux États membres. La politique sociale, l'environnement, la recherche et le développement ont ainsi bénéficié d'un cadre juridique commun. L'AUE a également simplifié et harmonisé les règles du marché commun, améliorant son efficacité. Le nombre de directives et réglementations européennes a augmenté significativement après l'adoption de l'AUE.
Le marché intérieur (1993) : la suppression des frontières intérieures
La réalisation du marché intérieur, un objectif majeur de la Commission Delors, a transformé la réalité économique de l'Europe. En supprimant progressivement les obstacles à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, le marché intérieur a accru la compétitivité des entreprises européennes et dynamisé l'économie. Le secteur agricole, par exemple, a subi une profonde restructuration avec l'abolition progressive des quotas laitiers. L'impact sur l'emploi est complexe et a été sujet à des débats. La création du marché intérieur a été officiellement déclarée achevée le 1er janvier 1993, une étape clé dans l'histoire de l'intégration européenne.
L'union économique et monétaire (UEM) : L'Euro, symbole d'une intégration profonde
L'Union Économique et Monétaire (UEM), dont l'aboutissement fut l'introduction de l'euro en 1999, représente un pilier essentiel du "choix de Delors". La création de l'euro visait à réduire les coûts de transaction, à renforcer la stabilité monétaire et à promouvoir une plus grande intégration économique. Ce projet ambitieux a exigé un long processus de négociations et la mise en place de critères de convergence économiques stricts. La comparaison avec d'autres zones monétaires (ex: zone dollar) souligne la complexité du projet européen et l'importance des facteurs politiques et institutionnels dans sa réussite. L'introduction de l'euro a profondément transformé les marchés financiers européens.
La politique sociale européenne : un enjeu de cohésion
Jacques Delors a accordé une place importante à la dimension sociale de l'intégration européenne. La Commission Delors a œuvré à mettre en place des politiques visant à réduire les inégalités, à améliorer les conditions de travail et à promouvoir la cohésion sociale. Malgré des progrès dans certains domaines, la politique sociale européenne s’est heurtée à des limites, en particulier face aux pressions néolibérales qui ont favorisé la compétitivité économique au détriment des protections sociales. Le taux de chômage au sein de l'Union européenne est resté un défi majeur durant cette période.
- Le traité de Maastricht, signé en 1992, a formellement institué l'UEM.
- L'euro est devenu la monnaie officielle de 19 pays de l'UE en 2002.
- La création du Fonds social européen vise à soutenir l'emploi et la formation professionnelle.
L'élargissement vers l'est : intégration et défis
Sous l'impulsion de Jacques Delors, les bases de l'élargissement de l'UE vers les pays d'Europe centrale et orientale ont été posées. L’intégration de ces pays, après la chute du mur de Berlin, constituait un défi considérable. Il a fallu adapter les institutions européennes et mettre en place des mécanismes d'aide financière pour soutenir la transition économique de ces pays. Cet élargissement, commencé dans les années 1990, s'est poursuivi par la suite, augmentant considérablement le nombre d'États membres de l'UE. Le budget de l'UE a été considérablement augmenté pour financer cet élargissement. L'adhésion de la Pologne en 2004 a marqué une étape importante de ce processus.
L'héritage de Delors : succès et limites
Le "choix de Delors" a incontestablement contribué à une période de croissance économique significative, à une paix durable et à une plus grande stabilité politique en Europe. Cependant, ce modèle a aussi suscité des critiques, notamment concernant les inégalités persistantes, la crise de la dette souveraine de 2010 et la montée des populismes. La crise financière de 2008 a révélé les failles d'un système d'intégration économique trop poussé sans une gouvernance politique suffisamment robuste. Le PIB de la zone euro a connu une croissance significative au cours des années 1990. L’adoption du traité de Lisbonne en 2007 a tenté de répondre à certaines des critiques formulées contre le système institutionnel européen.
Le transfert de compétences vers les institutions européennes a soulevé des questions importantes concernant la souveraineté nationale. La perception de ce transfert a varié d'un État membre à l'autre, reflétant des intérêts et des sensibilités différentes. Les pays du Nord de l'Europe ont, par exemple, souvent privilégié l'intégration économique, tandis que les pays du Sud ont mis l'accent sur les dimensions sociales et solidaires. Le Brexit, en 2016, symbolise ces tensions.
- Le PIB de la zone euro a augmenté de X% entre 1985 et 1995.
- Le nombre de membres de l'UE a presque doublé depuis 1995.
- Le budget de l'UE a considérablement augmenté pour financer l'élargissement.